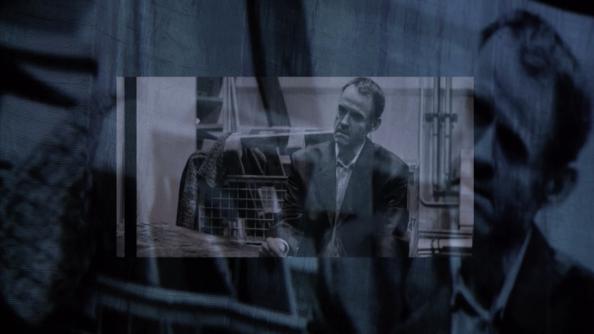
Alfred de Musset: Lorenzaccio
Mise en scène: Michel Belletante
Avec : Steeve Brunet, Renaud Dehesdin, Thibault Deloche, Thomas Di Genova, Floriane Durin, Léo Ferber, Carl Miclet, Gilles Najean, Philippe Nesme, Marianne Pommier, Pierre Tarrare
Lorenzaccio est un drame romantique, en cinq actes, écrit par Alfred de Musset, en 1834, sur une idée de George Sand, qui lui avait confié le manuscrit de sa scène historique inédite intitulée Une conspiration en 1537. Il est publié en août 1834, dans le premier tome de la seconde livraison d'Un Spectacle dans un fauteuil.
Il y présente un héros romantique, Lorenzo. L'intrigue de cette pièce est une reprise d'événements réels racontés dans une chronique de la Renaissance sur la vie de Florence au xvie siècle : la Storia fiorentina de Benedetto Varchi. Mais Musset a modifié la fin de l'histoire. En effet dans la réalité, Lorenzo s'enfuit, reste en vie encore quelques années et sa mère, elle, survit, alors que le personnage de la pièce se laisse tuer après avoir appris le décès de celle qui lui a donné la vie. Les anachronismes et "erreurs" historiques sont en fait nombreux dans le drame, montrant à quel point la fidélité historique n'était pas la priorité du dramaturge. En ce sens, on peut donc bien dire que c'est un drame romantique que Musset a écrit à partir d'une scène historique.
Il a été joué, pour la première fois, de façon posthume, au théâtre de la Renaissance en 1896, dans une version en cinq actes et un épilogue, mise en scène par Armand d'Artois, avec Sarah Bernhardt dans le rôle-titre.
L'action se déroule à Florence en janvier 1537. Le patricien florentin Lorenzo de Médicis1, âgé de dix-neuf ans, jeune homme studieux, admirateur des héros de l'Antiquité latine et grecque, se voue à la restauration de la République. Tâche difficile : son lointain cousin, le duc Alexandre de Médicis, règne sur Florence en tyran avec l'appui du Saint-Empire et du pape2 ; une garnison allemande assurant sa protection.
Lorenzo devient fidèle serviteur du duc, son familier ainsi que son compagnon de débauche. Il projette de le tuer pour libérer Florence de ce tyran, parce qu'il estime les grandes familles républicaines trop passives et trop lâches pour faire leur devoir. L'acte de Lorenzo semble d'avance voué à l'échec, car il agit seul. Personne ne l'en croit capable et nul n'a le courage de tirer parti de son acte pour instaurer à Florence un régime moins tyrannique.
Contexte historique
L'histoire se déroule à Florence en 1537, dans les deux dernières années du règne d'Alexandre de Médicis (1536-1537). Pendant cette période la ville de Florence est contrôlée par Charles Quint, empereur du Saint-Empire et par le Pape. Ces derniers nomment à la tête de la ville Alexandre de Médicis, un être vil et débauché.
La ville est ici le théâtre d'affrontements qui ne sont pas sans rapport avec la situation que Musset vient de connaître en France avec l'échec des journées révolutionnaires de juillet 1830. Néanmoins, toute la pièce ne reflète pas l'Histoire de France en 1830, Musset laissant libre cours à son imagination pour écrire ce texte de « spectacle dans un fauteuil », pièce ayant la particularité de n'être conçue que pour la lecture, suite à l'échec des deux seules représentations de La nuit vénitienne, les 1er et 3 décembre 18303.
Au pur Lorenzo succède donc celui que les Florentins appellent Lorenzaccio, en ajoutant à son nom le suffixe -accio marquant le mépris. Incarnant toute la débauche de sa ville, Lorenzo jouera donc un double jeu pendant toute la pièce, celui de « Lorenzino », héros romantique par excellence, empli d'idéaux et inspiré par les deux Brutus, et celui de « Lorenzaccio », personnage corrompu et pervers, qui lui collera bientôt à la peau. Mais Lorenzo sous ses airs de débauché et de lâche est aussi un homme d'épée idéaliste, courageux et poétique (comme dans la scène 11 de l'acte IV, celle du meurtre du Duc où Lorenzaccio redevient Lorenzo l'espace d'un instant). La dualité et l'ambiguïté du personnage éponyme est l'une des richesses de cette œuvre dramatique4.
Le mouvement romantique a vu le jour au xixe siècle, avec des auteurs comme Nerval, Lamartine ou encore Alfred de Musset. Dans un contexte politique trouble et agité, avec un pouvoir en proie aux protestations de la jeunesse, Musset « l’enfant prodige » compose un théâtre rempli de symboles, et libéré des contraintes formelles classiques. L’œuvre est, selon les termes de Musset, un « spectacle dans un fauteuil ». Celle-ci possède cinq actes, mais tous ne sont pas de consistance et de densité égales, car les quelque trente pages qui constituent les huit scènes de l’Acte V font pâle figure face aux cinquante feuillets du précédent. De ce fait, le cinquième acte peut donc paraître moins complet et plus insignifiant que les autres, bien qu’en réalité il porte les marques d’un véritable dénouement.
Il a d’ailleurs souvent été supprimé des versions contemporaines de mise en scène, et atrophié voire dénaturé dans certaines rééditions modernes. Mais si Alexandre de Médicis est tué à la fin de l’acte IV, Lorenzo, lui, meurt, mis en pièces par le peuple, durant cet acte. Le couple Cibo se reforme pour faire bonne figure, le cardinal tire, dans l’ombre, les ficelles secrètes qui lui permettront de s’assurer un contrôle du pouvoir, et la vague républicaine qui aurait dû naître dans le sillage de l’épée de Lorenzo reste très timide. Pourquoi les enjeux de cet ultime élément dramaturgique sont-ils éminemment nécessaires à l’œuvre ?
Comment l’acte V confère-t-il un éclairage nouveau, plus pessimiste, à l’action, et oriente le lecteur vers une interprétation plus nuancée des conséquences de l’assassinat du tyran ? Pour répondre à cette interrogation, il convient de montrer en quoi ce dernier acte remplit l’office de dénouement de l’intrigue principale, où un Lorenzino protéiforme lutte contre la tyrannie, et également des deux intrigues secondaires : la marquise de Cibo qui tente de séduire le duc dans un but indépendantiste, action détournée par le cardinal pour servir ses propres intérêts, ainsi que la famille Strozzi qui construit, parallèlement, sa vengeance. Ensuite, nous verrons comment l’auteur cherche à donner un sens différent, plus résonnant, à l’ensemble de son œuvre en dépeignant l’éternel retour de la vicissitude et le pessimisme, voire la lâcheté des héros républicains face à la situation. Il faudra également étudier la valeur autobiographique donnée par Alfred de Musset à cette partie de la pièce, dans laquelle il laisse entrevoir toutes ses désillusions après la révolution ratée de juillet 1830. Enfin, il sera judicieux d’étudier la perception que le lectorat a eu, et a actuellement de ce dernier acte. Nous chercherons à comprendre les limites inhérentes à l’acte V qui, sans doute parce qu’il veut crier un message trop fort pour cette époque, semble multiplier les difficultés qu’un metteur en scène peut avoir à le représenter…
Dans un premier temps, on peut dire que l’acte V constitue véritablement le dénouement de toutes les intrigues de Lorenzaccio : en effet, il permet au lecteur de mieux cerner les enjeux du texte et de comprendre pourquoi le personnage de Lorenzo reste si énigmatique, si triste et ironique à la fois. La ville de Florence résonne des discours cyniques des commerçants et des seigneurs, désabusés et, pour la plupart, sans espoirs. L’ultime partie de l’œuvre clôture ainsi toutes les questions laissées en suspens, en accentuant l’effet d’accélération de l’action par une binarité des lieux (Florence-Venise) et par un rétrécissement du temps (les scènes I à IV ont lieu dans la même journée du 6 janvier ; les scènes V à VII le lendemain matin).
Tout d’abord, l’intrigue dramatique centrale se referme apparemment bel et bien sur la mort du duc Alexandre de Médicis : la formule employée par Lorenzo à l’attention de Scoronconcolo (« Attends ! Tire ces rideaux. », scène XI de l’acte IV) est une métaphore qu’opère l’auteur, perpétrant une mise en abyme, un théâtre dans le théâtre. L’action semble donc terminée, la scène rendue à son obscurité naturelle par les rideaux refermés. Pourtant, le mouvement reprend à nouveau dans le dernier acte, qui s’ouvre magistralement sur le grand débat des seigneurs conservateurs, désireux de nommer au plus vite un nouveau duc pour Florence, au moins par régence, avant que la nouvelle ne s’ébruite et vienne compromettre le régime qu’ils eurent tant de peine à établir. Pendant ce temps, Lorenzo est à Venise, à l’abri des murs du cabinet de Philippe Strozzi. Malgré cette apparence de protection, le Conseil des Huit ne tarde pas à l’accabler du meurtre de son cousin éloigné en mettant sa tête à prix (« À tout homme, noble ou roturier, qui tuera Lorenzo de Médicis, traître à la patrie, et assassin de son maître, […] il est promis […] », scène II de l’acte V). Dès lors, ceci permet au lecteur de comprendre que le destin du antihéros, poussé à la limite de la schizophrénie par le contraste total entre son habit de vice, son masque de luxure et une âme qui fut jadis pure et studieuse, est scellé.
Ce passage nous fait entrevoir un personnage radicalement orienté vers l’autodestruction : un Lorenzo qui ne veut pas redevenir un simple homme et survivre d’une vie calme et sans remous. Mû par cette ivresse du geste accompli, il paraît déjà plongé dans une mélancolie profonde. Dans la scène II, le monde qui l’entoure, son vieil ami Philippe essayant de le congratuler (« Laisse-moi t’appeler Brutus », et « mon grand Lorenzo ! ») n’ont que peu d’importance à ses yeux. Le processus dramatique est à son apogée dans le dernier acte. Même la clé de sa chambre, devenue le tombeau d’Alexandre, n’a plus qu’une valeur symbolique, il délègue la gloire de l’Histoire à d’autres que lui. Ce désintérêt croissant est illustré par deux répliques : « Philippe, je t’apporte le plus beau joyau de ta couronne », « Je ne nie pas l’histoire, mais je n’y étais pas. ». Nous pouvons donc affirmer que c’est un héros déjà fragilisé, brisé par le rôle de lâche et de déluré qu’il a dû jouer durant tant d’années, qui parle ici de son accomplissement personnel comme d’un fardeau presque oublié, laissé à l’appréciation d’autres juges que lui. Serait-ce parce qu’il a eu la prémonition de ce qui allait arriver à l’objet de toutes ses dévotions, la mère souillée qu’est Florence ?
L’avant-dernière scène élimine le dernier résidu d’espoir que Lorenzo avait en lui. Elle s’ouvre directement, sans transition, sur son entrée tenant une lettre lui apprenant le décès de Marie Soderini, la mater dolorosa qui soutint son fils jusqu’aux confins de la tristesse et de la folie. Cette nouvelle bouleverse un peu plus un héros déjà éreinté, qui se définit dans la scène VII comme étant « plus vieux que le bisaïeul de Saturne ». Le lyrisme exacerbé du héros amène le lecteur-spectateur à percevoir derrière ces paroles lasses et dégoûtées la crise identitaire et le malaise d’un adolescent face au monde « adulte », qui lui répugne par ses injustices et ses incohérences. C’est grâce à cet acte que l’on admet enfin la possibilité que l'acte héroïque ait été guidé aveuglément par une soif de crier son mal-être au monde entier, finalement radicalement égoïste.
Ce surplus de négativité le fait définitivement basculer dans un vertige suicidaire. Finalement, le meurtre ne l’a libéré que partiellement : il se sent vide (« je suis plus creux et plus vide qu’une statue de fer-blanc »), délaissé par ceux pour qui il avait voulu agir (« […] que les républicains n’aient rien fait à Florence, c’est là un grand travers de ma part »), et il sort dans la rue en direction du Rialto, accomplissant ainsi son suicide indirect. L’effet de cette provocation du destin ne se fait pas attendre : en sortant, il est abattu par derrière, sans panache, et n’a même pas droit à un enterrement ; il meurt comme il a vécu. Le corps de Lorenzo finit dans la lagune de Venise. L’auteur pousse une ironie déjà retentissante jusqu’à son paroxysme en faisant assassiner celui qui aurait dû être le guide de la nation par le peuple lui-même. (« Pippo : Monseigneur, Lorenzo est mort / […] le peuple s’est jeté sur lui, […] on le pousse dans la lagune »). Le lectorat n’a apprécié que très variablement cette fin presque attendue et qui ne laisse rien espérer, mais les drames romantiques comme Lorenzaccio sont avares en fins heureuses…
L’intrigue secondaire de Cibo trouve un écho tout à fait révélateur et nouveau dans ce dernier acte. Alors que les seigneurs de Florence sont en train de proposer des noms pour le trône vacant de duc de Florence, l’ambiance fiévreuse de la crainte et de l’inquiétude s’installe. Mais, non sans garder à l’esprit les rouages machiavéliques qui leur assurent le contrôle de la ville, des dirigeants, eux-mêmes manipulés, échangent fausses courtoisies et vraies attaques, comme le prouve Palla Ruccellaï en votant blanc. Dans l’acte V, ces engrenages sont symbolisés par le personnage du cardinal Malaspina Cibo, qui condense derrière sa robe d’ecclésiastique tous les vices prêtés à la tyrannie du Pape et de Charles Quint. Il représente l’image même de l’arriviste qui désire à tout prix accéder aux plus hautes instances politiques et religieuses. Dans cette optique, il va même, durant toute la pièce, tenter de détourner la relation que la femme de son frère, la marquise de Cibo, entretient avec le duc, à des fins politiques. La première scène de l’acte V est essentielle, car elle laisse parler les voix des membres du Conseil des Huit, qui explicitent la nature véritable du visage intérieur du cardinal. Le lecteur achève d’y découvrir un personnage des plus manipulateurs : il fait croire aux visiteurs que le duc est encore en vie, alors qu’il vient de périr dans la scène précédente (« […] le duc a passé la nuit à une mascarade, et il repose en ce moment », bien que l’omission volontaire du pronom « se » avant le verbe rappelle au lecteur de la pièce ce qu’il en est en réalité… Prévoyant, il a envoyé un messager au Pape pour s’assurer d’être nommé ou que l’on fasse nommer un jeune homme facilement manipulable. L’acte V joue donc un rôle-clé, en ce sens qu’il sert à fixer le cadre d’un éternel recommencement, comme le mentionne la célèbre formule du cardinal, que Musset fait parler en vers latins « Primo avulso non deficit alter | Aureus, et simili frondescit virga metallo (Le premier rameau d’or arraché se remplace par un autre, et une nouvelle branche du même métal pousse aussitôt) ».
Finalement, Côme de Médicis, un jeune parent du duc assassiné qui fut élevé avec Lorenzo, remplacera ce dernier. Loin d’être libératrice, son arrivée sur le trône au milieu d’une foule rassemblée en grand nombre, comme l’indique la didascalie « Florence.-La grande place ; des tribunes remplies de monde. Des gens du peuple courent de tous côtés. », a le goût amer de la soumission à l’autorité du Pape et de Charles Quint. Côme, inexpérimenté, va devenir malgré son innocence le bras agissant du Mal, représenté par le cardinal, et auquel seuls quelques étudiants et une poignée de braves semblent s’opposer. La scène finale du couronnement de Côme laisse présager l’avènement d’un avenir heureux pour l’ambition démesurée de l’Église –et de son armée- qui veut soumettre l’Italie à son influence. La marquise est, quant à elle, brièvement évoquée dans la scène III, dont le décor est planté dans une rue de Florence. Formant une paire littéraire avec son contraire, le cardinal, l’opposition est absolue, l’idéalisme se heurte au machiavélisme. Les deux gentilshommes qui constatent la réconciliation du couple Cibo constituent la voix de l’opinion publique. Là encore, la lâcheté occupe le premier rôle, car les commérages (« Qui ne sait pas, à Florence, que la marquise a été la maîtresse du feu duc ? ») cèdent leur place aux railleries moqueuses (« […] avaler une couleuvre aussi longue que l’Arno, cela s’appelle avoir l’estomac bon ») pour enfin se métamorphoser en crainte empreinte de bassesse à la mention des talents de guerrier du marquis (« Si c’est un original, il n’y a rien à dire. ») La femme mûre qui voulait, en utilisant ses charmes, servir l’idéal républicain, se retrouve finalement soumise à l’influence du regard populaire et doit se ranger derrière l’épaule de son mari qui, d’ailleurs, fait comme si de rien n’était.
Elle s’efface et se comporte de telle manière que l’on pourrait croire que tous les problèmes de la ville et de la nation sont réglés, alors qu’il n’en est rien : ce n’est qu’un masque de plus dans l’immense carnaval de l’œuvre de Musset. Cet ultime acte est donc la clé de voûte d’une complexification autour du duc car, même mort, celui-ci autorise la modification des valeurs individuelles. Le lecteur est en droit de se demander si cette réconciliation est réelle, témoignant ainsi de la beauté de certains sentiments (l’amour, le respect, etc.), ou si elle ne fait qu’ajouter à l’absurdité de la situation florentine. Tout converge vers un effet de peine prolongée et d’épuisement poétique pour que le lecteur s’identifie au héros romantique tiraillé par ses passions internes face à un monde qui le dégoute. Le cas de l’intrigue Cibo dans le dernier acte met donc en relief l’aspect psychologique et historique du drame de Musset, en cernant les habitudes néfastes du xvie siècle, à rapprocher du fameux « mal du siècle » au xixe.
Enfin, il est également nécessaire de traiter de la dernière intrigue, lancée en même temps que les autres dans l’acte premier, et qui concerne quant à elle la facette politico-sociale de la pièce, avec pour actants les membres de la famille républicaine Strozzi. L’acte V est essentiel, en ce sens qu’il donne au public l’occasion de mesurer le changement d’attitude de Pierre Strozzi : au départ, il luttait contre l’oppresseur pour venger l’affront fait à sa sœur par Salviati. Mais lorsque Louise Strozzi meurt empoisonnée et que celui-ci l’apprend au sortir de son séjour en prison, la culpabilité commence à le ronger. L’acte V montre, même si Pierre n’y apparaît que dans la scène IV, que le combat qu’il avait engagé pour la liberté s’est mué en multiples vengeances personnelles, puis que, aigri de n’avoir pas été accepté pour son propre caractère par les troupes républicaines, qui ne jurent que par le nom de son père Philippe, il reproche à Lorenzo de lui avoir « volé sa vengeance » (« Maudit soit ce Lorenzaccio […] ma vengeance m’a glissé entre les doigts comme un oiseau effarouché », scène IV). Il a rallié l’ennemi, l’armée française (« Pierre est en correspondance avec le roi de France »), parce qu’il est prêt à tout pour détruire ceux qui ont symboliquement détruit sa propre famille (avec la mort de Louise et l’exil de Philippe).
Nous pouvons donc en déduire que même les républicains, qui sont censés représenter la paix et la justice dans la hiérarchie quasi-manichéenne de l’œuvre, sont eux-mêmes en proie aux vices et à la démesure. C’est une défaite pour la Justice. Cet acte final met au monde une ville à bout de souffle, où la vérité sort de la bouche des enfants de la famille Salviati et de la famille Strozzi, toujours en opposition, qui s’insultent et se chamaillent. Pendant ce temps-là, le lecteur voit progresser un arrière-plan politique et social réaliste, avec la scène des étudiants (scène VI) –aujourd’hui controversée comme nous le verrons plus loin-, et les dialogues entre précepteurs et entre le marchand et l’orfèvre par exemple. Quant au personnage de Philippe, vieux sage empreint d’idéaux durant toute la pièce, cet acte le met en lumière en le présentant comme un ami intime de Lorenzo, qui cherche à le protéger et qui tient, plus que Lorenzo lui-même, à sauvegarder la santé et la jeunesse de ce dernier. Cette relation pure, où Philippe devient le père par procuration du jeune homme (il est d’ailleurs décrit de façon très similaire au véritable père), est particulièrement visible dans les scènes II et VII, avec des phrases comme : « Je suis plein de joie et d’espoir » (foi en l’avenir), « Cache-toi dans cette chambre. » (instinct paternel), ou également « Partons ensemble ; redevenez un homme ; vous avez beaucoup fait, mais vous êtes jeune. » (désir de raisonner). Le cinquième acte lui prête une connotation positive : il garde foi dans le réveil des républicains florentins et espère un renouveau gratifiant…
On peut donc dire que l’Acte V constitue un vrai dénouement, faisant suite à la parodie de solution qu’était la mort du duc. Le peuple, représenté par les gentilshommes, les précepteurs, le marchand et l’orfèvre, n’a pas voulu donner suite à l’acte héroïque isolé d’un Lorenzo fataliste. Dans un second temps, nous verrons que ces scènes, qui concluent sur une lâcheté généralisée, sont marquées par la volonté de l’auteur de donner un sens différent, plus résonnant, à l’œuvre tout entière, par le biais du pessimisme et d’une certaine valeur autobiographique.
D’abord, le dernier acte érige en monument l’accomplissement d’un destin, c’est la triste victoire d’un héros incompris face au monde « adulte », lâche et vain. « J’étais une machine à meurtre, mais à un meurtre seulement », dira Lorenzo pour se qualifier. Ainsi, la fatalité tragique a guidé sa vie, sans qu’il sache lui-même pour quoi il agissait, et l’a conduit au pied du mur, face à l’impasse du néant ou de la mort. Sa destinée est vide de tout sens, il a fait ce qu’il devait faire au regard des valeurs qu’il tenait pour justes. L’effet recherché est le dégoût, celui d’une lucidité aigüe, presque violente, à un tel point que le Lorenzaccio « sauveur de Florence » se moque totalement de ce qui adviendra de Lorenzino, de Renzo et de toutes les autres facettes de sa personnalité. Si, dans les quatre premiers actes, l’illusion des dialogues pouvait rendre une impression d’unité, les monologues laissant apparaître un personnage protéiforme et déchiré entre ses plusieurs « moi », l’ultime acte est l’épilogue de cet écartèlement psychologique, où le personnage s’aliène et devient étranger à lui-même (« c’est assez, il est vrai, pour faire de moi un débauché », -où l’emploi de la passivité prouve qu’il est déjà à demi parti du monde- et « je porte les mêmes habits, je marche toujours sur mes jambes, […] [mais] je suis plus creux et plus vide qu’une statue de fer-blanc. », montrant son désintéressement vis-à-vis de sa propre existence). Musset relègue en coulisses la mort de Lorenzo. L’Histoire évacue le héros sacrifié ; la fin du duc, si longuement fantasmée par le héros, reste, malgré une brève illusion de rédemption, de l’ordre de la banalité. Le dramaturge insiste sur le contraste entre rêve et réalité, sacrifice personnel et conséquences historiques. La mort du duc n’a pas apporté ce qu’en avait espéré Lorenzo. Toute la pièce traduit ce désespoir politique et moral : Lorenzo parle brièvement d’une pureté vite évanouie, mais Florence n’en tirera aucun profit. Les haines farouches et les sentiments violents des enfants Strozzi et Salviati, ainsi que la superstition du marchand lors de l’épisode des « six Six » (scène V) forment un contraste absolu avec sa rêverie nostalgique et lasse. Lorenzo est donc un rêveur qui rêve sa propre vie, un dormeur qui a essayé de transcender une action négative pour une cause juste afin de se réveiller. Mais dans le fond, le lecteur comprend grâce à cet acte que son désir le plus intime est de mourir, peut-être parce qu’il estime avoir écrit suffisamment de lignes dans le grand livre de l’Histoire.
Ensuite, c’est cet acte de clôture qui démontre précisément le romantisme inhérent à l’œuvre tout entière. Un pessimisme global typiquement romantique établit le mythe de l’Eternel retour, dans lequel Florence-la-catin, la prostituée forcée de laisser mourir ses enfants, est promise à un mariage malheureux avec Côme, un dirigeant inexpérimenté soumis à un pantin malfaisant. « Je suis très persuadé qu’il y a très peu de très méchants, beaucoup de lâches et un grand nombre d’indifférents. », mentionne Lorenzo, qui n’a pourtant qu’une vingtaine d’années. Les républicains sont mous, ils hésitent, « ils ont haussé les épaules, […] ils sont retournés à leurs dîners, à leurs cornets et à leurs femmes. » Il sait déjà à quoi il peut s’attendre au sein d’une société du xvie siècle qui traverse une période de crise totale. Perdus au cœur de ce monde peu réjouissant, certains se tournent vers la superstition (le marchand), d’autres vers une érudition aveuglée (les précepteurs, qui parlent de poésie alors que les enfants combattent), d’autres encore vers l’art (Tebaldeo, les sculpteurs par exemple) et les derniers vers le vice (le cardinal). Mais de tous ces refuges émanent les mêmes voix désespérées, qui sont traduites de diverses manières dans le dernier acte de l’œuvre. Une œuvre qui, à bien y regarder, nous donne les éléments d’une critique acerbe de la société contemporaine dans laquelle évoluait l’auteur. « À des jours meilleurs », se disent ainsi les bannis avant que leurs routes se séparent dans l’acte I. Ce mince espoir en un temps de prospérité et de bonheur est aussi présent dans le dernier acte, qui confirme son rôle fondamental dans cette intention positive, onirique : « Si je suis un rêveur, laissez-moi ce rêve-là. (Philippe) », ou encore « sois tranquille, j’ai meilleure espérance ». En effet, on retrouve cette idée de fatalité, de luxure et de décadence, loin du mos majorum, de l’Âge d’Or qu’avaient apparemment connu certains habitants de Florence : « Il y en a qui voulaient rétablir le conseil, et élire librement un gonfalonier, comme jadis », signale le marchand en scène V. Cet acte éclaire donc l’état léthargique, mélancolique des citoyens, et rappelle, dans une moindre mesure, le sommeil délicat, enfantin, de Lorenzo.
Enfin, il est possible de déceler de nombreux éléments autobiographiques que l’auteur a glissés dans les interstices de ses lignes : disséminés au cœur de cet acte qui rappelle fortement son adolescence, ils soulignent l’importance de ce dernier. Par exemple, lorsque Musset était scolarisé au collège royal Henri IV, il obtint le premier prix de dissertation latine et le second prix de la même discipline au Concours général. Il mentionna également, dans l’une de ses lettres à son ami Paul Foucher, beau-frère de Victor Hugo, sa « passion pour les lettres latines ». Ce goût pour la culture antique, nous le retrouvons dans le passage en latin, scène I de l’acte V (« Primo avulso […] virga metallo. »), qui n’est autre qu’une citation de l'Enéide de Virgile (vers 143-47, chant VI). Le personnage de Lorenzo se mêle au Musset adolescent, hésitant entre s’engager politiquement et baisser les bras face à un monde impossible à sauver… Comme dans le poème La Nuit de Décembre, où « cet étranger vêtu de noir » semble être le double de l’auteur, le personnage éponyme de son Lorenzaccio se remémore son enfance qui le suit, semblable à une ombre, toute sa vie durant. Lorenzo est tout particulièrement une incarnation de Musset, lequel se figurait d’ordinaire en deux personnages fraternels et contradictoires. Le personnage est en grande partie la voix même de son créateur dans son apport au romantisme poétique, par sa capacité à maintenir le lyrisme sentimental dans l’ironie qui devrait le désamorcer, et le renforce pour finir. Les thèmes de la dépersonnalisation, de la mélancolie du double et surtout de la solitude transpirent à travers l’acte V, en forme de signature, qui s’appose comme l’un des éclats du portrait d’Alfred de Musset sur le drame. Pour finir, on peut noter l’importance du vote blanc de Palla Ruccellaï ; « il ne faut plus à la république ni princes, ni ducs, ni seigneurs : voici mon vote », qui dissimule à la censure omniprésente l’avis de Musset quant à la vraie couleur de l’idéal républicain. Cet acte final porte en lui les ferments de La Confession d’un enfant du siècle, son célèbre et unique roman publié en 1836, analyse lucide d’une maladie morale, le « mal du siècle », ou le désarroi d’une jeunesse française débauchée au lendemain de la Révolution et de l’Empire. « Il est doux de se croire malheureux, quand on n’est que vide et ennuyé », écrira-t-il dans ce roman.
Musset communique avec son époque grâce à son incommensurable talent, mais va parfois jusqu’à faire mentir la teneur « historique » de la pièce en commettant quelques erreurs. Mais peut-être fut-ce volontaire ? Une adaptation lyrique vers un contexte plus moderne a pu rendre un allégement de la complexité présente chez Varchi obligatoire…
Dans un troisième temps, il faudra considérer que l’acte V trouve plutôt ses limites dans le fait qu’un message trop fort peut nuire à cette tentative de définition sociale. Cet acte fut d’ailleurs censuré sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire, puis régulièrement supprimé des représentations scéniques et des rééditions du drame.
D’abord, il faut signaler que cet acte fut souvent supprimé, partiellement ou totalement, pour diverses raisons au rang desquelles figurent la faible durée de ses scènes et la grande diversité de personnages sur scène, mais également la présence d’erreurs et de passages très controversés. En tous les cas, cette partie de l’œuvre a généré de nombreuses discussions et déclenché les tornades opaques de quelques débats houleux, plus que n’importe quel autre acte. Là se trouve donc l’un des enjeux majeurs de la postérité du Lorenzaccio du Musset, de cette pièce qui se nourrit des avis de lecteurs, de spectateurs et de critiques. La scène VI de ce dernier acte représente une émeute des étudiants contre les soldats allemands, la force d'occupation de Charles Quint, au nom du droit des Florentins à disposer d'eux-mêmes et à participer à l'élection de leurs propres dirigeants : « Citoyens, venez ici ; on méconnaît vos droits, on insulte le peuple » ; et « nous voulons mourir pour nos droits ». Elle évoque la seule résistance qu'ont opposée quelques Florentins au tour de passe-passe imposé par le cardinal Cibo et accepté par les Huit à la scène 1 de l'acte V, et suggère qu'il n'y a rien de changé à Florence après le meurtre du duc : seuls quelques individus résistent, tandis que la masse se réjouit, ou subit en se résignant. La symbolique d’arrêt de tout mouvement, l’inertie, est donc un motif qui réapparaît très souvent dans la fin de la pièce. La dernière réplique de la scène VI : « Venge-moi, Ruberto, et console ma mère », est une invitation à la vengeance qui suggère que le processus de la violence n'est pas terminé et qu'il y aura d'autres tentatives à l'avenir. Cette scène repose pourtant sur un contresens de Musset lisant Varchi : « Avvenne, che 'l lunedì sera a due […] fuora, fuora i soldati forestieri ! […] palle, palle ! […] con loro andarono molti della città. (dans la Storia Fiorentina d’origine, tome V) ». Lorsqu'il lit : « palle, palle ! », Musset croit à tort qu'il s'agit de boules, c'est-à-dire d'instruments de vote comme en France où l'on peut se faire blackbouler. Or il s'agit du motif héraldique des besants (ou tourteaux) sur les armoiries des Médicis : loin d'en appeler à un vote démocratique chez Varchi, les Florentins lancent au contraire un cri de ralliement, un plébiscite, à la même famille régnante. Mais ce contresens de Musset s'explique dans la mesure où, depuis 1830, la révolution est confisquée par la bourgeoisie française. La France a en effet connu des épisodes insurrectionnels, en particulier celui des canuts à Lyon en 1831 et l'insurrection républicaine à Paris en juin 1832 : dans les deux cas, l'insurrection a été écrasée.

Théâtre de Bourg en Bresse
Le Théâtre construit en 1778 a vu sa façade et toiture classées en 1975. La forme et l’aménagement que nous connaissons date des derniers travaux entre 1997 et 2002.
Le Théâtre s’engage auprès des habitants de Bourg-en-Bresse en leur présentant des spectacles au Théâtre ainsi que dans l’espace public. Mais il part également à la rencontre des habitants de l’Ain grâce aux programmations dans le département avec les dispositifs Terr’Ain de jeu et les Petites Scènes Vertes.
Le Théâtre est un service public de la culture ; il accompagne à sa mesure la décentralisation culturelle, ce dans une réflexion commune avec les partenaires institutionnels afin d’inventer de nouveaux projets collaboratifs au service de toute la population du département.
Le Théâtre soutient activement la création régionale en accueillant des artistes en résidence, en coproduisant des spectacles et en s’impliquant activement dans les réseaux culturels régionaux. Il soutient notamment les compagnies du département grâce au dispositif Ain’cubateur pour les artistes en création.
Le Théâtre s’engage aux côtés des artistes, en particulier les artistes et compagnies associés afin de monter des projets ensemble, soutenir des œuvres et sensibiliser le public aux arts vivants.
Michel Belletante

Dans la mouvance des stages CREFATS de Gabriel Cousin, co-animés entre autres, par Georges Lavaudant, Michel Belletante fonde sa première compagnie théâtrale en 1979. Détaché de l’Institut de Cologne en RFA, il est chargé de mission audiovisuelle en 1981-82, en liaison avec toutes les institutions locales et les chaînes de télévision. De retour en France, il participe à la création du Centre Théâtral de Bourg en Bresse, avant d’animer fin 1985, avec Michel Pruner, le théâtre des 30 à Lyon, jusqu’en 1989. Il y met notamment en scène Pirandello et La Chute de Camus, avec Maurice Deschamps. En coproduction avec la salle Gérard Philippe de Villeurbanne, il écrit et présente Werther d’après le dramaturge est-allemand Ulrich Plenzdorf. Il devient ensuite assistant de plusieurs metteurs en scène, dont Bruno Carlucci à Lyon. Dans le cadre d’une convention de développement entre la ville de Pont de Claix (38), la DRAC Rhône-Alpes et la Préfecture de l’Isère, il crée en résidence, à l’Amphithéâtre de Pont de Claix, Le Tartuffe de Molière en 1992 puis le Don Juan de Bertolt Brecht d’après Molière en création française. Au théâtre des Ateliers, en juin 1994 à Lyon, il a mis en jeu Proses du fils, un texte d’Yves Charnet, un premier roman paru aux éditions de la Table Ronde, avec Nino d’Introna du Teatro dell’Angolo. Il travaille depuis régulièrement avec ce metteur en scène, nommé directeur en 2004 du Centre Dramatique National de Lyon dédié aux jeunes publics, le Théâtre Nouvelle Génération. Ils mettent ainsi en scène conjointement Vestiaires en 1995 sur le rugby. Michel Belletante est nommé directeur de l’Amphithéâtre de Pont de Claix en 1996, scène conventionnée Rhône-Alpes. Il est également enseignant à l’ENSATT, l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (Lyon). En 2000, il monte, seul cette fois, le Cas David K., un spectacle fantastique et métaphorique sur le thème de la métamorphose, repris à l’Amphithéâtre puis en tournée à l’automne 2001. Il collabore de nouveau avec Nino d’Introna pour les Caprices de Marianne d’Alfred de Musset, George Dandin de Molière, La Locandiera de Goldoni et Vestiaires repris en 2007. En 2004, il crée Couples en (dé)construction et en 2005 une pièce inédite écrite par Fabrice Melquiot Je peindrai des étoiles filantes et mon tableau n’aura pas le temps, présentée au festival off d’Avignon la même année. Il signe également les mises en scène des spectacles du groupe de chansons Entre deux Caisses, lauréat du grand prix de l’Académie Charles Cros. En 2007, il a créé Nous les Héros de Jean-Luc Lagarce, dans le cadre de l’année Lagarce. Il présente en janvier 2008, l’adaptation du texte d’Anne Delbée : La 107e minute, et en mai 2008, il crée à l’Amphithéâtre Le barbier de Séville de Beaumarchais ainsi qu’une folle nuit consacrée à l’oeuvre de ce même auteur.
En avril 2009, il met en scène Iphigénie de Jean Racine, et conçoit pour l’occasion une Nuit Racine dédiée à cet auteur en collaboration avec Anne Delbée pour laquelle il assurera le regard artistique de La leçon de Phèdre en octobre.
En novembre 2009, il crée Le silence des communistes à l’Amphithéâtre de Pont de Claix et en janvier 2010, il écrit, conçoit et met en scène une nuit Brecht.
En mai 2010 il conçoit et joue le dernier spectacle de la Scop Amphithéâtre à Pont de Claix : Surprises !
En septembre 2010 il est licencié par la nouvelle municipalité de Pont de Claix et quitte la direction de l'Amphithéâtre où il oeuvrait depuis 14 ans.
La compagnie qu’il dirige depuis 1995 « Théâtre et Compagnie » est alors approchée pour commencer une résidence de quatre ans auprès du Théâtre de Vienne. Cette même équipe de création est retenue par l’équipe du Chapiteau en Isère pour la tournée de l’automne 2010 avec Nous les Héros de Jean-Luc Lagarce.
En mai 2011, en coproduction avec le Théâtre de Vienne il met en scène La jeunesse des Mousquetaires d’après Alexandre Dumas.
En mai 2012, il est chargé de la réalisation du Printemps de Vienne, pour lequel il organise une Nuit Brecht restée dans les mémoires.
Il vient de créer en janvier 2013 Lorenzaccio d'après A. De Musset et G.Sand en tournée cette saison. Il créera en 2014 à Vienne, une Nuit Musset les 4,5,7,8 février.
- Metteur en scène
Écrit par {{comment.name}} le {{comment.date}}
 Cinefeel, documentary & fiction
Cinefeel, documentary & fiction  Dramateek, drama theatre and related
Dramateek, drama theatre and related  Jazzee jazz & world music
Jazzee jazz & world music  ClassicAll, for classical music lovers
ClassicAll, for classical music lovers 
{{comments.length}} Chapitrage(s)